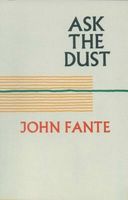Je chante un baiser.
Soyons claire. "Béa" n’est ni le meilleur rôle, ni le dernier qu’ait obtenu Sylvie Testud. D’abord consacrée en Allemagne, où elle a obtenu en 1997 le German Film Awards de la meilleure actrice, elle est pourtant, au moment où s'engage, début 98, le tournage de Karnaval, une parfaite inconnue en France. Mais c’est justement ce film qui constituera, de ce côté du Rhin, le point de départ de sa carrière française (qui lui vaudra notamment de décrocher en 2004, à 33 ans tout juste, le César de la meilleure actrice pour Stupeur et tremblements).
Normal. Dans un film placé entre fiction et documentaire, qui réalise une captation respectueuse de ce qu'est Carnaval chez nous, elle irradie littéralement de la tête (bien faite) et des épaules (solides) le cortège ; et si son interprétation m'a tant marquée, c'est d’abord parce que d’un bout à l’autre, cette sans-grade est le vrai Tambour-Major de la bande qui l'entoure, ne s'en laissant jamais compter par les deux Matantes qui l'accompagnent.
Soit : deux gigolos et une gigolette guinchant de guingois au Bal de la Violette ; trois masquelours ballotés jusqu'à plus soif (c'est une image) par le rigodon des sentiments ; trois héros ordinaires perpétuellement sur un fil tendu entre la joie et le délire, l'alcool et… le vomi ; qui, à la cantate finale, auront beaucoup perdu mais également beaucoup gagné de cette lessive des corps et des esprits que constitue aussi notre petite fête locale. Au final : quatre-vingt-dix minutes de tension amoureuse et d'angoisse sourde, illuminées par la vision d'un ange.
Dans ce triangle amoureux aux allures de tragédie grecque, Béa c'est Phèdre au pays des sirènes de bateaux et des usines qui grondent, Antigone surgissant sous l'averse pour se perdre dans le tourbillon de la fête, Electre dégrisée trouvant encore la force de recoller les morceaux.
Et de ce baiser qu'elle donne, comme ça, sur un coup de tête, parce que c'est Carnaval et qu'à Carnaval les baisers ne comptent pas, enfin pas vraiment, enfin un petit peu quand même mais il ne faut pas le dire, c’est juste une petite transgression, un petit message de rien du tout, un témoignage d'affection disons, et d'ailleurs ici un baiser se dit zôtche, et même zô, et entre nous qui peut bien avoir peur d'un mot si petit ? De ce baiser qu'elle donne, disais-je, un soir d'euphorie où une fois de plus elle s'est montrée la plus posée, à ce Larbi qu'elle ne connaît pas, tandis que Christian, son mari, dort tout son soûl, on imagine les quiproquos amoureux qu'un Marivaux en eût tiré ; dans le film, cette pelle roulée à la va-vite dans une cage d'escalier va prendre les accents d'une épopée humaine.
Je chante un baiser / Je chante un baiser osé / Sur mes lèvres déposé / Par une inconnue que j'ai croisée / Je chante un baiser… / Marchant dans la brume / Le cœur démoli par une / Sur le chemin des dunes / La plage de Malo Bray-Dunes / La mer du Nord en hiver / Sortait ses éléphants gris vert / Des Adamo passaient bien couverts / Donnant à la plage son caractère / Naïf et sincère / Le vent de Belgique / Transportait de la musique / Des flonflons à la française / Des fancy-fair à la fraise… (Alain Souchon).
Karnaval, c’est la quête initiatique de Larbi (Amar Ben Abdallah), fils de garagiste en instance de départ qui, ayant manqué le train qui doit l'emmener à Marseille – "la ville où il ne pleut pas" – va découvrir que l'endroit où il a grandi recèle bien des trésors de chaleur et de partage. Larbi, c'est l'arabe, c'est l'Etranger rejeté par tous (même par son père) qui parviendra, en ouvrant son cœur, à s'intégrer – par et dans la fête ; Larbi, c'est celui qui regarde la foule d'abord avec les yeux de la condescendance, et qui finira, au petit jour, par entrer dans la ronde, comme les autres…
Karnaval, c’est le chemin de croix de Christian (Clovis Cornillac), brave gars d'min coin comme j'en connais cent par ici ; vigile dans un entrepôt de containers, il pose ses congés pour Carnaval, parce que Carnaval ici c'est sacré ; un carnavaleux comme tant d'autres, capable de passer des heures dans la salle de bains à peaufiner son grimage ; Christian qui apprendra à ses dépens que quand la fête est finie, parfois le masque tombe, et qui paiera chèrement cette découverte. Et avec lui, on gardera au coin des lèvres ce petit goût amer de la gueule de bois du lendemain (autre spécialité locale).
Mais Karnaval, c’est également une mise en scène s'attachant au quotidien de ses personnages avec un souci proche du détail, où on les voit rentrer bourrés dans leur logement HLM, pousser leur chariot à Auchan, se battre comme des chiffonniers et surtout : travailler, même dans les environnements les moins charmeurs, disons, de la Côte d’Opale.
Et cette Béa-là voyez-vous, c'est le portrait craché de ma sœur.
(photos X)…